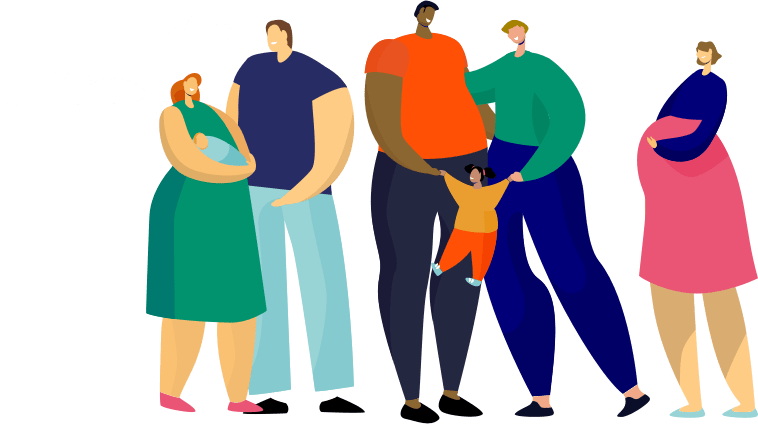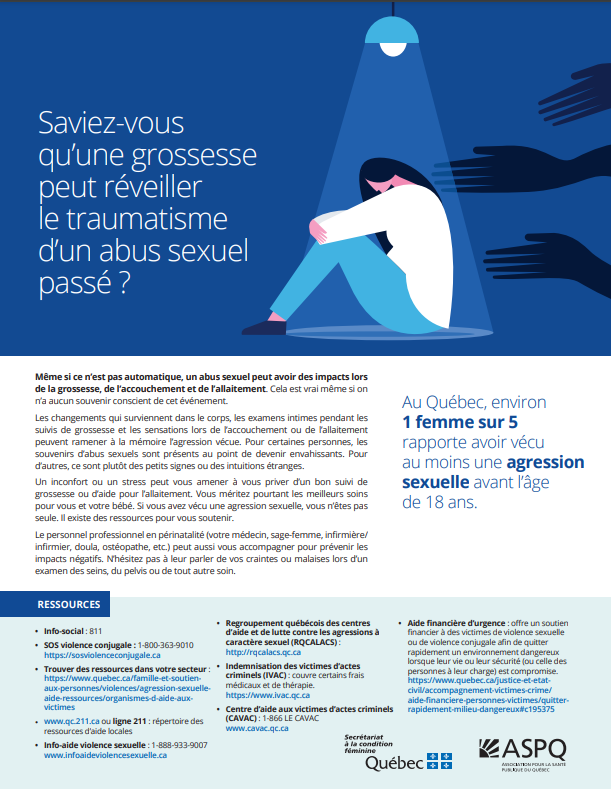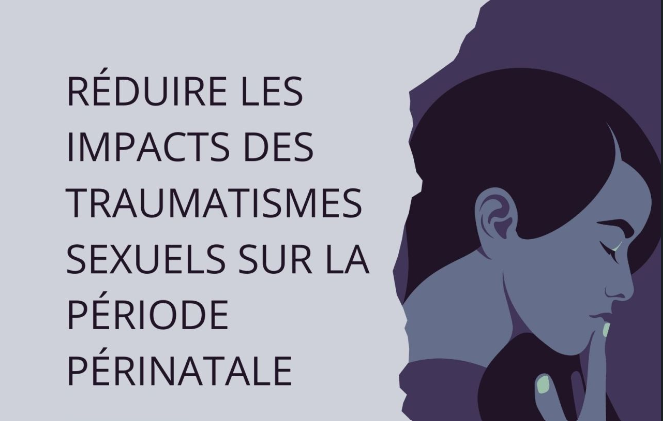2022
Appui au mémoire de Médecins du monde intitulé "Santé sexuelle et reproductive des femmes vivant au Québec. L'urgence d'agir pour garantir le bénéfice des régimes publics d'assurance pour toutes les femmes, peu importe leur statut migratoire."
Mémoire Médecins du monde 2022